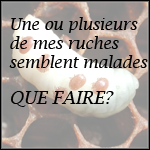- Détails
Lors du congrès Apimondia 2025 à Copenhague, la chercheuse grecque Fani Hadjina a présenté une étude préliminaire préoccupante concernant la pollution de la propolis. Ses recherches mettent en lumière l'impact du glycérol (glycérine) utilisé dans les nouvelles présentations d'acide oxalique en lanières (traitement longue durée), comme c’est le cas pour la spécialité Calistrip Biox.
Un taux de contamination qui pose question:
L'étude révèle que l'on peut retrouver des taux de pollution au glycérol atteignant 25 % dans la propolis après traitement.
Au-delà du problème de la contamination d'un produit destiné à la consommation humaine, une question fondamentale se pose. Comme le souligne Etienne Bruneau du CARI (lors de la conférence UNAF, à 1h07), quelles sont les conséquences réelles sur la colonie ? En effet, en altérant la propolis, on dénature une substance aux propriétés antibactériennes et antivirales puissantes, véritable « bouclier immunitaire » de la ruche.
Plus généralement, nous rappelons notre préférence pour les traitements « flash » à l’acide oxalique (par sublimation ou par dégouttement). Le choix commercial des lanières glycérinées expose les varroas à des doses d'acide sur une longue période, ce qui risque de générer des résistances à l'acide oxalique. Une telle évolution serait catastrophique pour la survie de nos cheptels.
Respecter le cadre légal et sanitaire:
Enfin, c’est l’occasion de rappeler que l’introduction de n’importe quelle substance dans nos ruches, (qu’elle soit alimentaire ou sanitaire) présente un risque parfois insoupçonné. Les conséquences peuvent être désastreuses et à l'opposé de l'effet recherché.
C’est pourquoi le respect des AMM (Autorisations de Mise sur le Marché) est fondamental et limite les risques. L'apiculture ne doit pas s'improviser : ne jouons ni au nutritionniste, ni au pharmacien, ni au vétérinaire.
- Détails
Petit rappel: la Journée de l'Abeille aura lieu ce samedi 13 décembre à Noiron-sous-Gevrey, Salle Polyvalente, 17 rue de l’Église. Début vers 9h30.
Le matin sera consacré a l’Assemblée Générale statutaire du Gdsa21 avec les nouvelles du sanitaire local (M Pechinot).
L’après midi, à 14h00, aura lieu aune conférence par M.Chouvenc (Apifleurs), très illustrée sur les plantes mellifères, suivie par celle du Dr Labourdette, vétérinaire du GDSA21 sur le sanitaire..
Un repas de midi est possible sur réservation. Informations sur le programme ICI.

M.CHOUVENC Photo JSL /Claudine DI GIOIA
- Détails
Les insectes, qui ont des larves et des adultes de morphologies différentes des adultes comme nos abeilles ou les papillons, sont classés comme holométaboles, à la diffrence d’insectes hétérométaboles, comme les sauterelles ou les blattes qui ont des larves ressemblant aux adultes. Les larves d’abeilles passent par 6 mues, dont 5 au stade larvaire. La royalactine de la gelée royale vous connaissez? Mon couvain est-il vraiment mosaïque ? C’est grave ? Le registre d’élevage est-il vraiment nécessaire ?
Une mine de renseignement très précis parsème le dernier bulletin du Dr Labourdette à consulter ICI !!
- Détails
La FREDON BFC a enfin reçu fin Août des fonds verts pour le remboursement partiel des factures de destruction de nids de frelons asiatiques pour 2025.
Ils sont destinés aux particuliers, sur facture, à condition que la destruction soit réalisée par des désinsectiseurs agréés par la FREDON BFC, à hauteur de 50 euros (pour la Côte d'Or). Il n'y aura pas de remboursement rétroactifs antérieurs au 19/08/25.
La liste des désinsectiseurs agréés est sur le le site de la FREDON BFC ICI ou sur notre site ICI
Les modalités de remboursement sont ICI.
N’oubliez pas de signaler vos nids de préférence sur le site frelon.com ou au numéro de la FREDON BFC dédié:: Manon Perrier au 07 57 01 13 81 qui vous rappellera.
- Détails
L’installation d’une harpe dans un environnement naturel sec propice au feu, notamment dans le sud de la France, a fait réagir avec justesse. On peut effectivement imaginer le renversement dune harpe par le vent ou un animal, et créer alors un court-circuit avec de l’herbe sèche avec un départ de feu.
Dans ces environnements particuliers, on peut installer un composant électronique sensible à la gravite, de préférence sans mercure, comme ce composant. Vous devez l’insérer en série à l’une des bornes sortie 4 v du régulateur qui alimente le module haute tension, en veillant qu’il soit bien vertical avec le circuit monté dans la boite. Lors d’un basculement intempestif, une microbille se déplace à l’intérieur du composant et coupe alors l’alimentation du générateur haute tension. Faire des essais avant de monter le boitier sur la harpe.